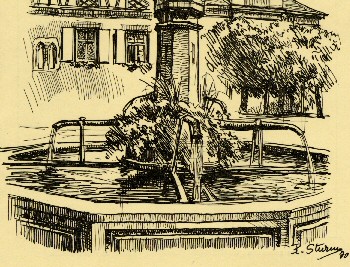 La
fontaine publique de Wintzenheim (détail d'un dessin de Pierre Sturm, 1970)
La
fontaine publique de Wintzenheim (détail d'un dessin de Pierre Sturm, 1970)IV - Wintzenheim - La noce : la première cérémonie du matin ; la distribution de la dîme ; les Tresses ; le grand cortège ; un air consacré ; la bénédiction nuptiale ; la bouteille cassée ; les cadeaux ; l'orchestre au complet ; garçons et filles d'honneur ; la salle de danse - Digression : des différentes transformations que subit ce local ; salle d'escrime au printemps ; grenier en été ; salle de spectacle en hiver : les marionnettes ; maître Rodolphe ; son répertoire à double fin ; annonces ; le public, le personnage d'Hansvurst - Retour au sujet ; la danse et le personnel de la danse ; rafraîchissements peu coûteux ; une maxime consolante.
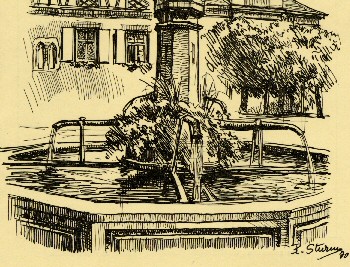 La
fontaine publique de Wintzenheim (détail d'un dessin de Pierre Sturm, 1970)
La
fontaine publique de Wintzenheim (détail d'un dessin de Pierre Sturm, 1970)
Le lendemain, je me levai de très bonne heure bien que je me fusse couché fort tard. Avant de rejoindre les autres invités chez les Marem, je voulais revisiter ce village où j'étais venu si souvent pendant mon enfance. Je le parcourus avec une naturelle et indicible joie. Bâti coquettement à l'entrée d'une des plus belles vallées de l'Alsace, celle de Munster, au pied même de la montagne du Haut-Landsberg, boisée de noirs sapins et couronnée d'un antique château (le château du Haut-Landsberg a été construit et fortifié, dit-on, par la maison de Hohenstauffen), rien de plus gentil et de plus pittoresque que ce bourg : voyez ces maisons bizarrement construites, les unes à pignons pointus et à devantures en bois ciselé, les autres, aux fenêtres projetées en saillies et en créneaux dits Erker ; regardez cette petite place publique plantée d'acacias et constamment rafraîchie par le voisinage d'une grande fontaine dont le bassin de pierre, alimenté par six tuyaux d'airain, sert d'abreuvoir aux bestiaux. Mais c'est en été surtout que Wintzenheim présente un aspect rustique tout à fait charmant : le matin, on voit sortir en mugissant, de leurs étables, les bœufs et les génisses, suivant au communal le pâtre de l'endroit qui, tous les jours, à la même heure, les appelle au son d'un agreste chalumeau. A cette époque de l'année, les collines et les vergers placés tout à l'entour du village, répandent partout de fortes et fraîches senteurs qu'on aspire avec avidité. Une brise délicieuse soufflant de la vallée, balaie la grande rue, tandis que deux bandes d'une eau limpide détournées de la Fecht (ruisseau qui sort des Vosges et se jette dans l'Ill, affluent du Rhin) et roulant parallèlement de chaque côté, traversent la localité dans toute sa longueur et se rejoignant ensuite à peu de distance du hameau, vont se perdre dans les détours de grasses prairies. Alors les jolies paysannes de la vallée, légères et court-vêtues, chassant devant elles des ânes chargés de paniers remplis de légumes, de beurre et d'œufs frais, viennent faire leurs offres de service aux mères de famille juives assises sur de grosses poutres et occupées à habiller et à tricoter.
Aujourd'hui, malgré un froid assez vif, une animation inusitée régnait dans le village. Hommes et femmes allaient et venaient, allègres et empressés. Lorsque dans nos campagnes il se célèbre une noce, tout le monde se fait en frais, comme si tout le monde devait en être.
Ce jour-là, on se lève de grand matin ; l'intérieur de chaque maison
présente un aspect de propreté particulier ; ce jour-là aussi, chacun fait un
peu de toilette. La raison en est simple : une noce attire toujours des
étrangers ; ces étrangers peuvent avoir des fils et des filles ; ces fils et
ces filles peuvent être en état de se marier ; un choix peut se décider ;
donc parents, jeunes gens et jeunes filles ont tous intérêt à produire une
impression favorable.
La synagogue de Wintzenheim (Guy Frank, octobre 2002)
Le fiancé, accompagné de ses proches, va de bonne heure au temple pour y faire sa prière ; il en sort à peu près vers huit heures pour aller au devant de la fiancée qu'on amène dans le péristyle de la synagogue. Là, se trouve un banc à dos, en acajou, et chargé d'inscriptions hébraïques. On fait asseoir les deux fiancés sur ce banc ; le rabbin déploie sur leurs têtes un voile blanc (thaleth) et sur ce voile les assistants répandent à l'envi des poignées de seigle et froment, emblème de fécondité future. On peut le dire, sans crainte d'être taxé d'impiété : au train dont vont les choses en Israël, cette formalité est presque superflue.
Quand je revins à la maison Marem, la cour était pleine et tumultueuse. Il y bourdonnait une foule confuse et bruyante qui se pressait impatiente autour d'une table placée au milieu. Sur cette table étaient étalées des piles de gros sous et de pièces d'argent, formant à peu près une somme de cinquante écus. Un homme - apparemment un ami de la maison - était là, faisant décliner leurs noms et qualités à tous ceux qui s'approchaient. C'étaient une véritable Babel de costumes, de langages et de cris. Il y avait là des hommes en blouse et en casquette, parlant à merveille le patois du pays : c'étaient des indigènes. D'autres portaient une redingote râpée, ornée de boutons bleus d'acier, un chapeau rond, un bâton de châtaignier surmonté d'une mèche de laine orange enlacée de fils de laiton ; leur allemand était un peu moins incorrect quoique encore singulièrement baragouiné : c'étaient des voisins d'Outre-Rhin. D'autres enfin, à la figure anguleuse, au front élevé, aux épaules carrées, portaient un couvre-chef à larges bords cachant mal de grosses boucles de cheveux noirs ; un cafetan de couleur douteuse, des bottes à revers autrefois cirées à l'œuf, étaient les pièces distinctives de leur costume ; ils prononçaient très distinctement u pour ou : c'étaient des sujets de sa Majesté Impériale, autocrate de toutes les Russies. Tous étaient des israélites indigents ; tous, Alsaciens, Allemands, Polonais, vivaient de la charité de leurs frères, chez qui, par un rare esprit de solidarité, ils étaient sûrs de trouver chaque vendredi soir bonne table et bon gîte, en échange d'une espèce de billet de logement dit blett. Ce billet est délivré aux israélites indigents dès leur entrée dans chaque bourg habité par des coreligionnaires. Il n'est pas de chef de famille, quelque modeste que soit sa fortune, qui le jour du repos, et son tour arrivé, ne se fasse un plaisir et un devoir de faire asseoir à ses côtés et, comme on dit là-bas, sous sa lampe, un de ses frères déshérités, et de lui faire oublier les tribulations de sa vie errante par l'hospitalité la plus cordiale et la plus familière. Aujourd'hui toute cette population vagabonde était réunie sur un seul point, attirée, comme de juste, par la noce. Ils venaient selon l'antique usage, toucher leur obole de la dîme ; généreuse coutume qui s'est maintenue parmi nous à travers les siècles et qu'observent surtout les juifs de la campagne ! Là, le plus humble des israélites ne recevrait-il en dot que cinq fois la somme de cent francs, soyez certain que le dixième de ce modeste patrimoine passera entre les mains des frères nécessiteux.
Pendant que je considérais la pieuse distribution, je vis passer, fendant la presse avec gravité, une dizaine de matrones se dirigeant vers l'intérieur de la maison. Leur costume, quelque peu suranné, me fit présumer que j'avais devant moi les doyennes du lieu ; elles étaient sans doute fort au courant des us et coutumes du pays, les jours de solennité comme celui-ci. J'avais comme le pressentiment qu'elles allaient procéder à quelque antique cérémonie qui n'admettait pas la présence d'un homme. Je me glissai sur leurs pas dans une petite pièce attenant à la salle basse ; puis je me blottis furtivement derrière la porte, en me masquant de mon mieux, à l'aide d'un vieux paravent troué placé par hasard à ma portée. Grâce à ce rempart transparent, je pus tout voir sans être vu. Au milieu de la chambre était assise la fiancée émue et pâle. Ses beaux cheveux noirs de jeune fille retombaient en boucles sur ses épaules, mais pour la dernière fois, hélas ! Près d'elle, et autour d'elle, chuchotaient un grand nombre de femmes. A l'entrée des matrones, tout le monde se leva. Les matrones traversèrent la pièce avec autorité, s'approchèrent de la jeune fille et distribuèrent des peignes. Aussitôt l'assemblée féminine, avec toute la ferveur que l'on met à accomplir un acte religieux, d'entourer la pauvre fiancée qui se laissa faire avec une pieuse résignation, de s'emparer à qui mieux mieux de ses cheveux, de se les distribuer en quelque sorte, de les séparer en tresses, de les rouler rapidement sur eux-mêmes, et de les refouler, sans grâce ni merci, sous un petit bonnet de satin noir qui devait les cacher à tout jamais. Les cheveux étant d'ordinaire, chez les Juifs surtout, un des plus beaux ornements de la femme, elle doit, dès son entrée dans la vie conjugale, en faire le sacrifice à son mari, renoncer ainsi, en sa faveur, à toute coquetterie, et s'ôter bénévolement tout moyen de plaire.
En vérité, je ne sais trop si le but que se propose la loi est toujours atteint : le joli petit bonnet orné de rubans roses et bleus qu'on place sur le bonnet de satin noir, et le bandeau de velours destiné à remplacer les cheveux, font souvent ressortir d'une façon très piquante les traits de la jeune mariée. Il est vrai que ce bandeau de velours lui-même, et à plus forte raison le tour inventé depuis, sont déjà des infractions à la vieille tradition ; celle-ci, ne souffrant pas même l'ombre d'un compromis, n'admettait, à la place des cheveux, qu'une simple dentelle, tombant sur un beau front blanc, donnait je ne sais quel air ravissant de pudeur et de chasteté.
Telle fut la cérémonie des tresses. Quand la fiancée redescendit dans la cour, le cortège se forma pour se rendre à la synagogue où la bénédiction nuptiale allait être donnée...
Copyright Guy Frank 2005