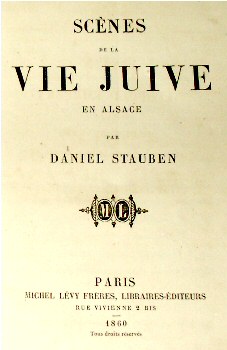 Les Scènes de la vie Juive en Alsace ont paru tout d'abord et à d'assez
longs intervalles (de 1857 à 1859), dans la Revue des Deux-Mondes. Nous les
réunissons aujourd'hui dans ce petit volume.
Les Scènes de la vie Juive en Alsace ont paru tout d'abord et à d'assez
longs intervalles (de 1857 à 1859), dans la Revue des Deux-Mondes. Nous les
réunissons aujourd'hui dans ce petit volume.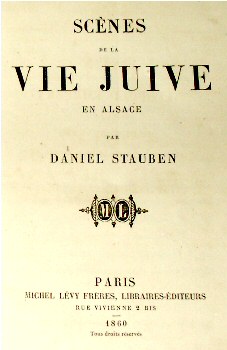 Les Scènes de la vie Juive en Alsace ont paru tout d'abord et à d'assez
longs intervalles (de 1857 à 1859), dans la Revue des Deux-Mondes. Nous les
réunissons aujourd'hui dans ce petit volume.
Les Scènes de la vie Juive en Alsace ont paru tout d'abord et à d'assez
longs intervalles (de 1857 à 1859), dans la Revue des Deux-Mondes. Nous les
réunissons aujourd'hui dans ce petit volume.
Qu'on nous permette de dire comment nous est venue l'idée de les écrire et quel en est l'esprit général.
Parmi les divers romans dus à la plume d'une illustre contemporaine, nous venions d'en lire quelques uns empreints d'un cachet particulier. Nous voulons parler de ceux, où laissant de côté toute théorie politique et sociale comme aussi la peinture brûlante des orages du cœur, l'auteur de la Mare-au-Diable et de François le Champy aborde des sujets plus calmes, moins irritants, et avec un rare bonheur, entre dans une veine nouvelle, celle de la vie rustique et de la poésie champêtre. Comme tout le monde, nous fûmes émerveillé à la lecture de cette série de petits chefs-d'œuvre. Ces récits si simples, ces tableaux si frais, cette naïveté de mœurs, ces curieuses chroniques de village, ces traditions populaires si gracieusement racontées, ces amours tout agrestes, ces individualités rustiques si bien étudiées, tout cela nous avait vivement impressionné. En même temps s'étaient éveillées en nous une foule de réminiscences ayant trait à un monde à la fois analogue et différent, si on peut le dire ; analogue par la bonhomie des habitudes, l'ancienneté des usages et l'originalité de certains personnages ; différent, par la religion qui sert de cadre à tout cela. Le Berry, me dis-je alors, n'est pas la seule contrée de la France où vivent des populations au caractère tranché, aux coutumes antiques, à l'idiome pittoresque. Aux paysans de l'Indre, on pourrait opposer sous plus d'un rapport, dans une autre sphère d'existence et d'idées, les Juifs de nos hameaux de l'Alsace.
Établis dans cette contrée depuis des siècles avant la conquête française, n'y ont-ils pas conservé un langage à part (1) et ne s'y sont-ils pas fait une vie à part aussi ? Vie, qui ne ressemble pas plus à celle des populations chrétiennes dont ils sont entourés qu'à celle de leurs coreligionnaires des villes ? La vie juive dans les villages alsaciens, me disais-je encore, ne présente-t-elle pas un curieux ensemble d'idées, de rites, de cérémonies, de superstitions, de traits de mœurs, de types campagnards, de fêtes périodiques (2), formant, le tout, comme une sorte de civilisation, double fruit, d'un côté, d'une antique croyance, et, de l'autre, des misères du moyen âge et des persécutions ? Spectacle intéressant, à coup sûr, pour le philosophe et pour l'artiste !
Tout en faisant ces réflexions, je me demandai pourquoi, après tout, en ma qualité d'Alsacien et d'Israélite, né et élevé au village, je n'essaierais pas d'initier le lecteur profane à cette vie si peu connue et si digne de l'être. Aidé de nos souvenirs d'enfance comme aussi des impressions résultant de quelques récentes excursions au pays, nous nous mîmes à esquisser les scènes qu'on va lire. On y verra les Juifs de l'Alsace dans les principales phases de la vie de famille et de la vie religieuse, au foyer et dans la synagogue. On fera connaissance avec leurs habitudes, leurs traditions, leurs légendes, leurs fêtes, leurs mœurs et leurs caractères. Nous avons cherché à dépeindre de notre mieux cette sorte d'antiquité judaïque contemporaine prête, hélas ! à disparaître ; car au train dont va le siècle, - le progrès et les chemins de fer aidant - quelques années encore, et il ne restera plus vestige de ces mœurs primitives. Déjà, en plus d'un endroit, elles s'effacent comme tout ce qui vieillit. Hâtons-nous donc d'en consigner bien vite les traits les plus caractéristiques.
Daniel Stauben
Paris, février 1860
(1) Un patois composé d'allemand et d'hébreu.
(2) Les Israélites des villes célèbrent les mêmes fêtes, sans doute, mais avec beaucoup moins de cérémonial et de solennité.
Copyright Guy Frank 2005